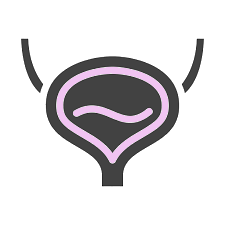Les germes responsables d’une cystite
Classification des germes uropathogènes
La colonisation des bactéries dans la vessie se fait par l’intermédiaire de germes pathogènes spécifiques. Ces derniers sont nombreux, de types moléculaires variables et donnent aux bactéries le pouvoir de se fixer à l’épithélium de la vessie.
Ces gènes sont classés en fonction de leur niveau de pathogénicité, en 4 groupes permettant ainsi une meilleure interprétation des urocultures.
Groupe 1 – Bactéries uropathogènes reconnues et considérées comme pathogènes même en cas de bactériurie faible (> 10^3 UFC/ml)
- Escherichia coli
- Staphylococcus saprophyticus (surtout chez la femme de moins de 30 ans.)
Groupe 2 – bactéries souvent impliquées notamment dans les maladies nosocomiales
- Entérobactéries autres que E. coli (Klebsiella spp, Proteus spp., Enterobacter…)
- Enterococcus spp.
- Corynebacterium urealyticum
- Pseudomonas aeruginosa
Groupe 3 – bactéries dont l’implication est peu probable en pathologie et exige un niveau de bactériurieélevé (>10^5 UFC/ml), ainsi qu’une répétition de leur isolement sur au moins deux échantillons d’urine.
- Staphylocoques à coagulase négative autres que S. saprophyticus
- Streptococcus agalactiae
- Aerococcus urinae
- Pseudomonaceae autres que P. aeruginosa
- Acinetobacter spp.
- Stenotrophomonas maltophilia
Groupe 4 – espèces appartenant aux flores urétrales et génitales (streptocoques a-hémolytiques, Gardnerella vaginalis, Lactobacillus spp. bacilles corynéformes
Les germes les plus fréquents sont les entérobactéries avec une prédominances pour E.coli (75% à 90% des cas) quel que soit le sexe et l’âge, toutes formes cliniques confondues. Cette colibacille est une bactérie de Gram négatif, mesurant 2 à 3 micron de long et sur 0,6 micron de large. Elle est l’hôte normal de l’intestin de l’homme et des animaux. c’est une espèce aérobie la plus représentée du tube digestif.
Les autres bactéries telles que Proteus ou Klebsiella sont présentes dans 15% à 25% des cas.
Le Staphylococcus saprophyticus concerne 1% à 4 % des infections urinaires, notamment celles touchant les femmes jeunes.
Le pouvoir pathogène des bactéries
Le pouvoir pathogène des bactéries répond à 2 mécanismes:
- la virulence propre des bactéries liée à leur pouvoir de multiplication
- La capacité de contamination de l’appareil urinaire et de dissémination de l’infection dépendant de facteurs d’uropathogénicité.
Les facteurs d’uropathogénicité sont nombreux et donnent le pouvoir à la bactérie de se fixer sur l’épithélium vésical. Cette adhésion peut être prolongée au niveau de l’appareil urinaire. Cela se traduit par la persistance de cultures positives à des concentrations non pathogènes de souches telles que E. coli après traitement d’une cystite.
Les adhésines
La colonisation bactérienne de la vessie est favorisée par l’attachement spécifique entre une adhésine bactérienne et le récepteur urinaire qui sont des éléments du mucus urinaire. Les adhésines peuvent être de type P-fimbriae (mannose résistant) ou Pili de type 1 (mannose sensible).
La spécificité de ce couple adhésine/récepteur explique le pouvoir pathogène entre une bactérie et un organe (dans notre cas il s’agit. d’E.coli et de la muqueuse vésicale). Ces adhésines sont portées de minces filaments présents à la surface de la bactérie.
Le lipopolysaccharide
Il s’agit d’un composant majeur de la surface de toutes les espèces bactériennes à Gram négatif. C’est un constituant hydrophobe de la paroi bactérienne composé de 3 entités: lipide A, le noyau et l’antigène O. Il possède une rôle pathogène majeur.
Chez les entérobactéries, le lipide A et le noyau sont peu variables tandis que l’antigène O est hypervariable et détermine la spécificité de la souche bactérienne. Le lipide A possède l’activité endotoxinique et induit la réponse immunitaire non spécifique. L’antigène O stéréotype les bactéries à Gram négatif.
Il influence aussi la réaction entre l’hôte et la bactérie selon différents niveaux (action du complémnet, phagocytose..).
L’antigène capsulaire
C’est un polysaccharide extracellulaire excrété par la bactérie. Cet antigène “K” est responsable de la virulence de la bactérie et la protège de la phagocytose et des réactions inflammatoires.
L’hémolysine
C’est une protéine responsable de la destruction des hématies. Elle est sous le contrôle des souches uropathogènes. Par exemple, l’hémolysine alpha d’E.coli a une action toxique et destructrice au niveau des cellules tubulaires rénales et inhibe l’action des cellules phagocytaires. Sa présence est rare (moins de 50% des cas de pyélonéphrites).
L’aérobactine
C’est une protéine bactérienne favorisant le métabolisme oxydatif du fer, ce qui améliore le métabolisme aérobie de la bactérie et augmente sa virulence.